Née en 1943 dans le 15e arrondissement de Paris, c’est à Charlottesville, dans l’État de Virginie aux États-Unis, que cette romancière et biographe réside actuellement avec son époux, leurs deux enfants et leur chien. En 1981, elle remporte le prix Femina pour son premier roman, Le Grand Vizir de la nuit (Gallimard) inspiré du conte La Fin de Giafar et des Barmakides des Mille et Une Nuits. Depuis, Catherine Hermary-Vieille n’a cessé d’alterner biographies et romans essentiellement historiques avec le même succès. En 1984, elle a obtenu le prix Georges-Dupau, une récompense littéraire administrée par l’Académie française, pour l’ensemble de son œuvre qui compte aujourd’hui près d’une trentaine de titres.
Partie en mission dans un Liban alors en pleine guerre civile pour réaliser un reportage sur le peuple libanais, elle découvre un peuple qui cultive la joie de vivre. Des hommes et des femmes qui gardaient leurs portes et leurs cœurs ouverts en dépit d’un quotidien insoutenable. Amoureuse du pays du Cèdre comme on tombe amoureuse d’un homme, son attachement pour ce pays ne cesse de croître tant et si bien qu’elle décide un jour d’imprimer dans sa chair et dans son cœur un peu de cette terre. Elle adopte alors Yasmine-Victoire, âgée de tout juste trois semaines, qui repart alors avec une maman d’amour. De ses allers-retours dans ce pays qu’elle chérit naîtront de grandes et belles amitiés. Aujourd’hui, elle partage sa vie entre la France et les États Unis, et sort son prochain roman à la rentrée.
Dans quel environnement avez-vous grandi ? Avez-vous eu une enfance propice à l’écriture ?
Je suis la cinquième d’une fratrie de six. J’ai grandi dans une famille très portée sur l’écriture et la lecture. Mon père était très lettré, et la culture occupait une place très importante dans notre quotidien. À l’époque, les femmes ne publiaient pas, mais j’avais deux tantes qui écrivaient beaucoup pour elles-mêmes. D’une famille champenoise, nous sommes restés très attachés au terroir, aux traditions et à la mémoire d’une vieille France provinciale et cultivée, bien loin de celle d’aujourd’hui, complètement à la déroute et nous avons conservé une maison de famille un peu mystérieuse où l’on se retrouve pour les vacances. C’est là, dans la quiétude de la campagne, que je consacrais mes moments au vélo et à la lecture. Nous n’étions pas gâtés, la télé, les portables et les ordinateurs n’existaient pas encore, on empilait les livres, Pierre Loti, Rudyard Kipling… Aujourd’hui, les jeunes ne lisent plus. Le climat de la France actuelle est très étouffant et nuisible à l’épanouissement des esprits. On subit une forme d’embrigadement et la culture se meurt, comme si on voulait tout effacer pour recréer une humanité nouvelle. Il n’y a plus de place pour les discussions, la communication ou les échanges.
À quel âge avez-vous commencé à écrire ?
Dès que j’ai su écrire, j’ai écrit ! Au départ, je plongeais dans un univers enfantin, des petites histoires d’animaux d’ours ou de lapins. À cette époque, nous avions une gouvernante, comme toutes les grandes familles, et les parents n’étaient pas aussi attentifs aux enfants comme le sont les jeunes couples aujourd’hui. Il fallait que nous gérions seuls nos émotions, alors j’écrivais, et l’écriture me permettait de m’exprimer. À 14 ans, j’ai commencé à aborder des problèmes plus sentimentaux, les jeunes amours étaient un terrain inconnu, un sujet tabou. Je demandais à ma sœur aînée de m’éclairer sur les choses de la vie. Après avoir obtenu mon bac, mon père, persuadé que mon chemin, celui de faire une licence en lettres, était déjà tracé, a mis du temps pour comprendre mon choix tout en le respectant. J’étais une jeune fille déterminée, j’avais décidé de m’inscrire à l’École nationale des langues orientales.
Pour mémoire
Lamia Ziadé : Durant les six mois d’écriture de ce livre, je n’ai fait que pleurer...
Pourquoi avoir choisi de faire des études de langues orientales ?

Le choix était spontané et instinctif, j’avais envie de lire les poètes dans leur langue. J’ignore la raison de cette orientation, mais c’était un univers qui m’attirait et me passionnait. Aujourd’hui, je peux lire et écrire en arabe, mais cela n’a pas eu plus d’incidence sur ma vie ni déterminé quoi que ce soit…
Comment l’écriture est-elle entrée dans votre vie ? Où l’histoire a-t-elle commencé ?
En déplacement à New York avec mon époux, j’ai acquis une certaine autonomie et découvert un monde culturel passionnant. À mon retour en France, forte de ce que j’avais emmagasiné et sous l’influence de mon professeur de l’Université de Nanterre qui nous avait raconté l’histoire de Haroun el-Rachid, un récit à la fois cruel et poétique, j’ai décidé de publier mon premier roman. J’avais trouvé le sujet passionnant à la manière des contes des Mille et Une Nuits. C’est ainsi que Le Grand Vizir de la nuit (prix Femina, 1981) a vu le jour. Le journalisme s’est ensuite présenté à moi. J’avais le goût de l’aventure et cela me plaisait beaucoup d’aller à la découverte de nouveaux horizons, mais ma carrière d’auteure a vite pris le dessus. Fascinée par l’histoire et les grandes figures, je me suis plongée dans l’univers de la dynastie des Valois, parcouru la vie du chevalier d’Éon, celle des femmes de Charles VII, d’Henry VIII, ou encore la triste destinée de Joséphine de Beauharnais, des personnages au parcours hors du commun. Il m’arrive souvent d’écrire à la première personne (Moi, chevalier d’Éon, espionne du roi, éd. Albin Michel) pour mieux endosser la peau du personnage, pénétrer son âme et son esprit. Et le fil se déroule… et moi je le suis.
Quel est votre rituel d’écriture ?
J’écris toujours le matin. Je consacre quatre à cinq heures à l’écriture et même si l’inspiration n’est pas au rendez-vous, je m’installe devant ma page blanche. Il ne faut pas attendre que la muse de l’inspiration vienne à votre secours, car elle ne viendra jamais. L’écriture est une vraie discipline, vous ragez pendant un quart d’heure et puis tout d’un coup quelque chose vous vient à l’esprit et vous partez comme un cheval au galop. J’écris à la main et c’est mon époux qui se charge de tout retranscrire sur ordinateur pour les corrections. Je ne suis pas familière avec la ponctuation, la grammaire française est très compliquée. On se demande comment faisaient les éditeurs face aux manuscrits de Flaubert ou de Zola. Plein de ratures avec des mots et des phrases dans les marges, je corrige plusieurs fois. Un livre doit se relire au moins quatre fois. Et si aujourd’hui on veut simplifier la langue française pour faciliter la tâche aux émigrés, on l’ampute de sa richesse et de sa beauté.
Écrire, pour vous, c’est quoi ?
C’est merveilleux ! J’échappe à moi-même, je n’existe plus, je rentre dans l’autre et je suis l’autre dans un parcours logique. Je deviens l’autre. Paradoxalement, si vous donnez vie à un être imaginaire, il va vivre sa propre vie et va la vivre presque sans vous et vous allez le suivre, comme les maillons d’une chaîne. Tout devient logique et se raconte dans une narration de cause à effet : ceci est parce que cela est, si cela n’avait pas été, ceci ne serait pas. Comme on suit le cours d’eau d’une rivière qui coule et qui traverse les paysages, les déserts, les forêts, les villages et qui va aboutir dans la mer comme le grand tout, sans disparaître. J’accompagne ces personnages avec beaucoup d’intérêt et cela m’entraîne ailleurs.
Vos amitiés dans le milieu littéraire ?
Jean d’Ormesson, mon grand ami, était une personne qui possédait magnifiquement la langue française et qui avait une malice dans les yeux, une curiosité de tout et une culture d’un autre siècle. Je me souviens d’un soir à un dîner avec Alain Decaux, Joseph Kessel et Michel Déon, tous ces hommes d’un âge avancé et dont l’esprit fusait. Ils se répondaient les uns les autres, avaient le sens de la répartie, c’était un feu d’artifice d’esprit et de culture. Même les jeunes académiciens d’aujourd’hui ne possèdent plus cette gymnastique de rebondir sur un mot, de faire un trait d’esprit là où on ne l’attend pas. Cet esprit français, qui brillait dans les salons du XVIIIe, du XIXe siècle et qui faisait de ces échanges et de ces conversations un pur bonheur, n’existe plus. On discutait, on abordait des sujets intéressants, la conversation avait du panache.
Qu’est-ce que vous faites quand vous n’écrivez pas ?
Aujourd’hui, je m’occupe de mon mari beaucoup plus âgé que moi et de la maison, je vois des amies, je marche au moins une heure par jour.
Votre dernière acquisition en matière de roman ?
L’ami arménien d’Andreï Makine, un livre émouvant et fort, et Le Jour d’après de Philippe de Villiers, sur l’écroulement de la politique française, beaucoup moins poétique et sans évasion aucune mais qui m’aide à comprendre à quoi va ressembler notre avenir. Il parle de la dislocation du monde paysan et de l’industrie.
Lire aussi
Marwan Najjar : J’aime être acteur en écrivant...
Quel regard portez-vous sur la nouvelle génération ?
Il m’arrive de recevoir beaucoup de manuscrits. La jeunesse aujourd’hui est pleine d’enthousiasme mais il lui manque une culture générale et des références. Elle parle beaucoup d’elle-même, de ses expériences, de ses histoires d’amour ou d’amitié, mais c’est toujours par rapport à un seul point de vue.
Le Liban et vous, c’est une longue histoire d’amour et d’amitié, comment est-elle née ?
En 1983, on m’a envoyée en mission au Liban pour réaliser un reportage sur la vie des Libanais durant la guerre. Je suis arrivée dans un pays qui m’a accueillie à bras ouvert et des gens souriants et affables malgré toutes les difficultés qu’ils traversaient, et cette espèce de joie de vivre comme seul rempart face à la mort. Je suis tombée amoureuse d’un pays comme on tombe amoureuse d’un homme. Pour moi, le Liban était un pays unique. J’avais beaucoup voyagé mais je n’avais jamais rencontré ce mélange de beauté, de culture et de profonde chaleur humaine. La deuxième fois que je suis revenue pour interviewer le président Amine Gemayel, nous sommes arrivés par hélicoptère de Chypre, le pilote nous avait déposés quelque part dans la montagne et nous sommes partis avec nos sacs à dos, sans le moindre contrôle. Comme j’étais aventurière, cela me plaisait énormément.
Comment expliquez-vous l’épisode Gabriel Matzneff dans l’émission « Apostrophes », vous qui étiez présente sur le plateau ?
Ce soir-là, c’est Denise Bombardier qui avait levé le lièvre. À l’époque, l’intelligentsia française acceptait la pédophilie. On ne jugeait pas les artistes qui exprimaient leur art comme ils l’entendaient, ils avaient tous les droits. C’était un bon écrivain mais un pervers qui pensait qu’il avait toute la liberté de s’exprimer. Lorsque sur le plateau d’Apostrophes, Denise Bombardier lui dit : « C’est en prison que vous devriez être », il s’est enflammé et s’est défendu.
Aujourd’hui, il y a une explosion de dénonciations poussée à l’extrême. Les hommes n’ont même plus le droit de vous regarder, ce qui ôte tout le charme aux relations. Il y a une hostilité hommes-femmes et celles-ci ne tolèrent plus les gestes d’attention et de galanterie. Il n’y a plus de place pour la complicité joyeuse.
Vous avez adopté une petite Libanaise, connaît-elle quelque chose de son pays d’origine ?
J’étais amoureuse du Liban et j’avais déjà un fils. J’avais envie d’un second enfant et ça ne se présentait pas. Je pensais qu’on ne pouvait avoir d’enfant que d’une personne ou d’un pays que l’on aimait, et moi j’aimais le Liban. Étant journaliste, j’avais beaucoup de connexions et c’est grâce à la crèche Saint-Vincent-de-Paul que j’ai pu adopter ma petite Yasmine, elle avait 3 semaines. Elle n’a jamais désiré revenir au Liban. Pour elle, sa vie a commencé lorsque je l’ai prise dans mes bras. C’était comme une rupture totale avec ses origines et le commencement d’une nouvelle vie.
Qu’est-ce qui vous a ramenée aujourd’hui à Beyrouth ?
Mes amis. C’est quand les amis souffrent qu’il faut être près d’eux. Mes très chers amis qui ont peur et qui s’angoissent et l’envie de leur dire que nous sommes là, qu’ils ne sont pas seuls.
Comment avez-vous retrouvé Beyrouth aujourd’hui ?
Pour moi, Beyrouth restera Beyrouth avec ses quelques moments de grâce, un reste de chaleur humaine malgré tout et cette joie de vivre, mais dans l’immédiat, sans aucune projection dans le futur. Les Libanais sont anéantis mais demeurent combatifs au jour le jour, ils vivent le moment présent autant que possible sans avoir aucune illusion sur l’avenir. J’étais très frappée par le manque total de foi dans l’avenir.
Pour moi, le Liban, c’est la racine de notre humanité, là où tout a commencé. Je ne peux pas penser que cela peut disparaître, nous sommes tous libanais quelque part. Mais je n’ai pas trouvé de répondant, le peuple cultive l’amertume et subit le sentiment d’impuissance, cela m’a désespérée.
Sortez-vous bientôt un nouveau roman ?
J’ai terminé d’écrire mon dernier roman où il est beaucoup question du Liban, Les Exilés de Byzance. Il aborde le sujet d’une famille qui part de Byzance, le long du Proche-Orient jusqu’au Sud pour arriver en Égypte, à l’époque du règne de Nasser. Une partie de la famille ira au Liban. Je me suis inspirée de l’histoire de la famille de Robert Sursock, un grand ami qui m’a beaucoup aidée. De Byzance à Alep, puis vers la Palestine et le Liban, une partie va s’installer à Beyrouth où ils feront fortune dans le secteur bancaire tandis qu’une autre partie de la famille repartira en Égypte où elle sera dépossédée de tout. C’est l’histoire d’une famille imaginaire mais dont l’histoire est jalonnée d’événements historiques réels. Car nous vivons tous dans un contexte historique.
Quel est le secret du bonheur selon vous ?
C’est d’être entourée des personnes qu’on aime et qui vous aiment. La solitude est le pire des maux.








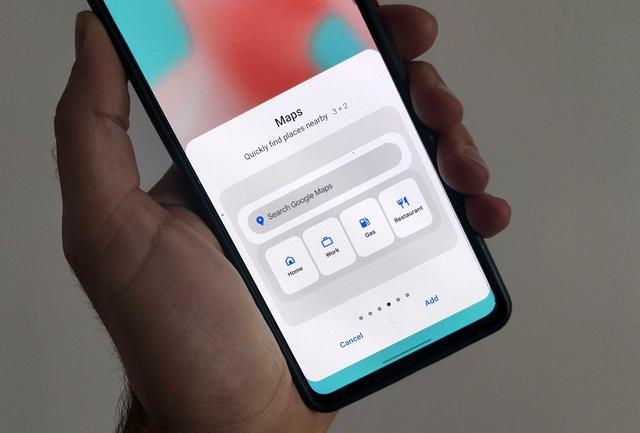

Adieu Touch Bar, je ne te regretter...
Caddy, l'unique serveur web à utili...
Burkina Faso / Gabon (TV / Streamin...
Ce que le futur du travail ne sera...