Le portrait de groupe des usagers du numérique publié cette semaine par NETendances confirme le basculement croissant de la vie en ligne au Québec : seulement 3 % des répondants adultes aux enquêtes menées en octobre 2021, après plus d’un an de pandémie, ont affirmé que leur temps passé devant un écran a « un peu ou beaucoup diminué ». On répète, 3 % du lot, ce qui correspond en gros à la marge d’erreur, alors aussi bien dire personne.
La société québécoise plus ou moins confinée par vague s’est branchée pour le travail, les films, les séries télé, les vidéocaptations, les études, la télémédecine, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les matchs du CH et le reste. Six adultes sur dix (58 %) ont avoué avoir augmenté « beaucoup ou un peu » les heures passées devant les écrans. Dans le groupe des 18 à 44 ans, ça grimpe à sept sur dix.
« La pandémie a eu un effet majeur sur l’utilisation du numérique par les Québécois : elle les a obligés à faire une transformation importante, à mieux s’équiper, à rechercher des services plus fiables et une plus grande panoplie de services dans certains cas, parce que leur vie devenait en partie virtuelle », résume Bruno Guglielminetti, porte-parole de l’enquête réalisée par l’Académie de la transformation numérique, rattachée à l’Université Laval.
L’enquête québécoise se concentre sur les adultes. Une recherche publiée dans le Journal of Affective Disorders Reports en décembre 2021 a établi que les enfants ontariens avaient consommé trois fois plus de temps d’écran que celui recommandé par l’Association des pédiatres canadiens. En moyenne, les enfants du primaire (6 à 12 ans) passaient 6 heures devant leurs écrans, mais certains totalisaient jusqu’à 13 heures de branchement à la télévision, à un téléphone, à un ordinateur, à une tablette ou à une console de jeux. En comptant une dizaine d’heures de sommeil, il restait donc une heure par jour pour le reste…
Nous naissons, vivons, mourons entourés d’écrans, maintenant plus que jamais. Même les livreurs ou les caissières ressemblent à des appendices de chair sur des machines électroniques, pour pasticher Marx. Est-ce donc l’adieu au désert du réel, selon la formule emblématique du premier film The Matrix, concentré de notre zeitgeist dont la quatrième itération vient de paraître sur un écran chez vous ? Croupissons-nous dans la caverne décrite par Platon, où les personnes enchaînées prennent les ombres pour la réalité ?
Homo numericus
Osons la question qui réveille : autant de temps d’écran, est-ce trop, docteur ?« C’est évidemment beaucoup plus complexe, et je pense qu’on ne pourra faire le bilan de cette expérience qu’à moyen terme », indique Florence Millerand, professeure de communications à l’UQAM, spécialiste des usages des technologies numériques. « On peut, chacun, chacune, voir les avantages et les inconvénients de cette situation. Les dynamiques sociales prennent du temps à se laisser observer. »
Cette prudence analytique faite, Mme Millerand avoue se reconnaître dans le portrait de ses contemporains, elle-même totalisant jusqu’à une douzaine d’heures d’écran par jour. Son enseignement se fait en ligne, avec « une énorme surcharge de travail », même pour elle qui s’y connaît en bébelles numériques. Ses enquêtes ethnographiques en souffrent. Des doctorants sous sa direction ont dû complètement repenser leur méthodologie de recherche.
« Il y a des effets pervers qu’on mesure moins immédiatement, une fatigue accumulée, un manque d’interaction sociale directe qui dynamise. On est très centrés sur la tâche et on a le sentiment juste de travailler plus et tout le temps. Toutes les tâches passent par le même média. »
Au fond, ici comme ailleurs, la pandémie n’a fait qu’amplifier des situations et exacerber des problèmes. La professeure Millerand rappelle qu’au tout début de ses recherches savantes sur le Web, il y a deux décennies, les opinions se divisaient en deux, avec des craintes de voir les enfants devenir amorphes et menacés par des prédateurs en ligne ou, au contraire, superinformés en profitant de toutes les connaissances à portée de clavier.
Ses enquêtes ont finalement révélé que les jeunes se branchaient pour échanger avec leurs amis et zieuter leur band préféré. « Au fond, ce qu’on fait en ligne n’est pas très différent de ce qu’on fait dans la vraie vie. »
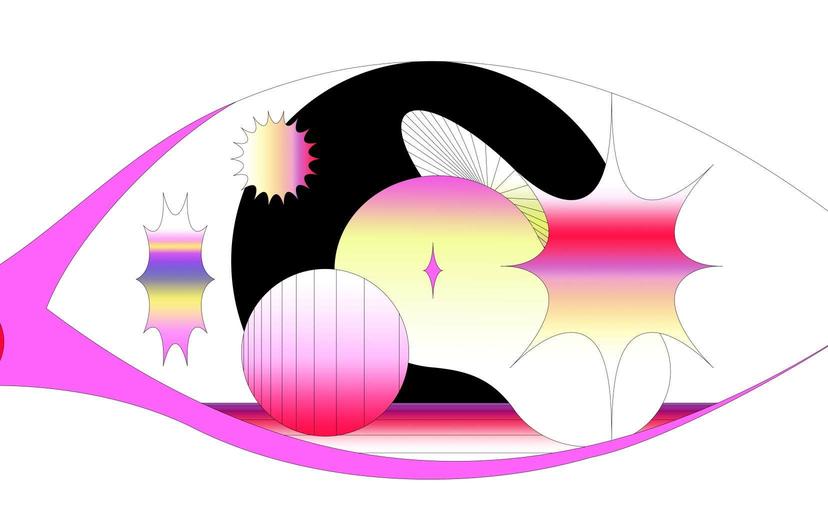
Le même et l’autre
Voilà donc l’écueil. Le réel et le virtuel sont-ils mutuellement exclusifs ? Est-ce même en ces termes qu’il faut situer ce débat fondamental dans nos vies comme dans la conception de l’existence ?
« Il faut faire une nuance entre le fait de dire que le réel et le virtuel sont séparés, en sous-entendant que ce sont deux mondes différents, et le fait de dire que ce sont deux dimensions de la réalité, affirme le professeur Stéphane Vial, de l’UQAM. Le virtuel est totalement réel. Moi, je préfère parler de la réalité numérique et de la réalité non numérique pour éviter les malentendus. Cette réalité numérique, c’est de la technologie, avec une empreinte écologique majeure et une empreinte psychologique majeure sur nous. »
Stéphane Vial a été un pionnier des recherches en philosophie du numérique avec sa thèse de doctorat publiée sous le titre L’être et l’écran : comment le numérique change la perception(2013). Sa phénoménologie du numérique propose de remplacer le terme « virtuel » par des concepts quicaractérisent différentes facettes du numérique. La réversibilité, par exemple, qui permet d’annuler et de refaire, une incongruité dans l’univers entropique non numérique. Ou la reproductibilité, qui engendre des copies instantanément ou presque.
Le terme « virtuel » n’est conservé que pour parler de la simulation. Sur un ordinateur, les dossiers ou la corbeille du bureau sont virtuels. Cette simulation née avec les interfaces graphiques n’a fait que prendre de l’ampleur avec les jeux vidéo, les métavers, tout ce qui est basé sur la simulation graphique interactive.
« Cette dimension pénètre dans nos routines quotidiennes et dans la vie courante, dit le philosophe. Elle intègre le réel, comme le téléphone ou l’électricité il y a un siècle. La pandémie a permis de faire l’expérience de cette réalité numérique comme jamais, jusqu’à des sommets inégalés de consommation d’écran pour les études, le travail, les loisirs, les relations interpersonnelles et le reste. Ce que je dis depuis dix ans, que le virtuel, c’est le réel, tout le monde l’a expérimenté à fond depuis deux ans avec la surnumérisation de tous nos usages. »
Il répète que nous ne vivons pas d’ombres, ni d’ombres d’une ombre. Il dit encore et encore que certaines expériences humaines ne peuvent être remplacées par l’écran, l’intimité amoureuse par exemple. Oui, l’univers numérique prend beaucoup de place, mais pour lui, dans les faits, il n’y a rien de nouveau à se colletailler à une technologie omniprésente.
« Nous sommes tous épuisés de la surprésence du numérique dans nos vies, y compris les gens comme moi qui défendent le numérique depuis longtemps, dit-il. Mais sans le numérique, on ferait quoi, actuellement ? Tout le monde s’inquiète du nombre d’heures que chacun passe par jour devant un écran, mais personne ne s’inquiète du nombre d’heures que passait par jour un moine copiste ou un étudiant devant le papier, dit le professeur Vial. Il ne faudrait pas oublier que l’être humain sécrète de la technologie. C’est ce qui nous distingue des autres animaux. »
La tête dans le nuage
Le philosophe australien David Chalmers, une des grosses têtes de la philosophie contemporaine, lance cette semaine Reality+, un essai dans lequel il plaide en faveur d’une grande plongée de l’humanité dans les univers numériques. Le professeur de l’Université de New York, théoricien de la conscience, nie lui aussi la distinction entre la réalité et la virtualité.
« Les mondes virtuels avec lesquels nous interagissons peuvent être aussi réels que notre monde physique ordinaire, dit-il dans une entrevue au Guardian. La réalité virtuelle est une réalité authentique. » Le professeur Chalmers ajoute que le développement d’appareils multisensoriels permet d’entrevoir d’ici quelques décennies, un siècle peut-être, un moment où réalité et virtualité deviendront indissociables.
Les gens pourraient alors choisir de s’insérer dans le numérique augmenté pour la plus garde partie de leur existence, prévoit le savant. Il envisage même cet univers comme monde de substitution en cas de catastrophes persistantes, mettons une pandémie éternelle…
Robert Dion enseigne la littérature à l’UQAM et ce n’est donc pas lui qui va remettre en cause l’importance des univers fictionnels dans nos vies. L’idée de faire basculer nos existences dans la « réalité+ » l’effraie pourtant. « S’enfermer dans un univers alternatif peut nous conduire à négliger notre propre monde, dit-il après avoir pris connaissance des thèses du philosophe Chalmers. En plus, on imagine bien toute l’énergie que va utiliser cette autre planète pour exister. Ce monde virtuel pollue le monde réel. C’est assez effrayant : si les gens pouvaient choisir et choisissaient de vivre dans le virtuel, à coup sûr, on serait foutus. »
Il repositionne la perspective pour rappeler que les cadres de vie, les balises éthiques, ne sont pas les mêmes dans le fictionnel et le réel, même si, comme le dit Shakespeare, les responsabilités commencent dans les rêves.
« Je pense aux influenceurs et aux anciens des émissions de téléréalité du vol Sunwing. Les gens se déchaînent parce qu’ils se comportent dans le cadre du monde réel de la même façon que dans le monde virtuel. Sur écran, on les regarde et on s’en amuse. Dans la vie, on s’offusque de l’inconscience et de la vulgarité de ces fêtards. Pourtant, les gestes peuvent être éthiquement et moralement aussi répréhensibles d’un bord et de l’autre. Moi, je crois que les gens qui se comportent de cette manière ne comprennent pas que les deux mondes ne sont pas radicalement différents. »
Simulacre et stimulations
L’homme de théâtre Olivier Choinière défend les vertus du théâtre comme espace de communication et de communion des humains entre eux et il envisage le pire avec le grand désistement numérique, virtuel, non présentiel des dernières années. Sur un réseau de Meta, il avouait il y a quelques jours qu’il avait même perdu l’envie d’aller au théâtre depuis la pandémie, parce que « le muscle [lui donnant] le goût de se rassembler et d’être en présence des autres ne répondait plus ».
« Le théâtre me semble politique, dans le sens où il permet de se rassembler et d’être dans le collectif, explique-t-il en entrevue. C’est un des rares lieux où on pouvait encore éprouver le sentiment de communauté en dehors de l’écran. »
Le goût des autres lui est revenu en repratiquant son art dans la rue avec le déambulatoire Vers solitaire (approuvé par la Santé publique), sans pour autant éliminer un arrière-goût de catastrophe pour son monde réel, trop réel. Le peu qu’il a vu des tentatives de sauvetage de certaines productions par des captations « streamées » ne l’a pas charmé, « bien au contraire ».
Il le redit : l’essentiel, c’est le réel, l’autre, son visage, sa voix, sa présence, ce qu’il retrouve et répète en ce moment avec le spectacle Zoé (théâtre Denise-Pelletier), arrêté en pleine lancée en 2020 et dont la reprise et la tournée sont prévues en mars 2022.
« Un spectacle vivant, ce n’est pas juste des données comptables, des chiffres, des revenus ou des emplois gagnés ou perdus, comme semblent le croire les gouvernements : c’est une expérience en temps réel d’une prise de parole publique. Cela fait partie, à mon sens, de la vie citoyenne, de la vie en société, du collectif et donc du politique. Le théâtre peut agir sur la peur et sur la peur de l’autre, si importante en pandémie. C’est aussi cela que l’on perd complètement de vue quand on est devant un écran. »
Les propriétés du virtuel
Le basculement en ligne s’accélère pour toutes les disciplines artistiques et culturelles. Le Centre Phi multiplie les présentations de réalité virtuelle, dont Carne y Arena (« Virtuellement présent, physiquement invisible », dit le sous-titre), du cinéaste Alejandro González Iñárritu, qui poursuit sa tournée nord-américaine à Dallas, au Texas. Pour ainsi dire là où la fiction immersive sur les migrants se déroule réellement.
À Londres, la Serpentine North Gallery reçoit cet hiver l’expo New Fiction, de l’artiste Kaws, divisée en trois parties. La première partie montre des oeuvres dans les salles, ce qui fait vraiment « derniers millénaires ». La deuxième partie, accessible grâce à un code QR, montre des oeuvres virtuelles, ce qui commence aussi à être banal. Le troisième volet, vendu comme une première mondiale, développe une autre version de l’expo, mais sur le site du jeu vidéo Fortnite, où la visite se fait en compagnie d’un avatar de son choix.
La plateforme ludique numérique offre de plus en plus de concerts à ses quelque 350 millions de joueurs. Le rappeur Travis Scott y a offert une prestation de 15 minutes qui a été vue par 27 millions de personnes, puis par 180 autres millions sur YouTube. La longue capsule aurait aussi généré 25 millions de dollars en vente de marchandises.
Les « propriétés virtuelles » font aussi sauter les banques réelles. Les spéculateurs gonflent les prix des cryptomonnaies, des oeuvres numériques authentifiées par jetons non fongibles et même des constructions pixélisées. Superworld, une planète virtuelle, vend des versions numériques de vrais monuments. La tour Eiffel numérique a été payée l’équivalent de 200 000 $ en bitcoins et le Taj Mahal, 400 000 $.
La grande mutation se concentre dans Facebook, le plus puissant réseau du monde, devenu Meta, une appellation contrôlée on ne peut plus transparente. En octobre 2021, son fondateur, Mark Zuckerberg, annonçait la création de son métavers en misant sur la prédiction que les humains allaient y passer de plus en plus de temps. De simples lunettes remplaceront bientôt les casques de réalité virtuelle. Rien qu’en Europe, la compagnie prévoit d’embaucher 10 000 employés pour construire ce monde parallèle au cours des cinq prochaines années.
Meta, comme bien d’autres géants du numérique, mise sur la transmutation du bon vieux Web en deux dimensions en un univers immersif, réseauté et tridimensionnel. Le terme « métavers » lui-même est emprunté au roman de science-fiction Snow Crash de Neal Stephenson, dans lequel le protagoniste, livreur de pizza, se divertit en se branchant sur Metaverse, un réseau de réalité virtuelle à l’abri des contrôles policiers.
À ce propos, le contraste de ces transformations profondes en marche accélérée reste frappant avec les rêves et utopies qui accompagnaient la naissance et le développement du Web il y a encore deux ou trois décennies. Comme les gouvernements balisent et surveillent les échanges en ligne, les géants du Web ont maintenant la mainmise sur les territoires numériques où ils édictent les règles. « J’ai vu le métavers et je n’en veux pas », affirmait cette semaine Keza MacDonald, chroniqueuse de jeux vidéo au Guardian.








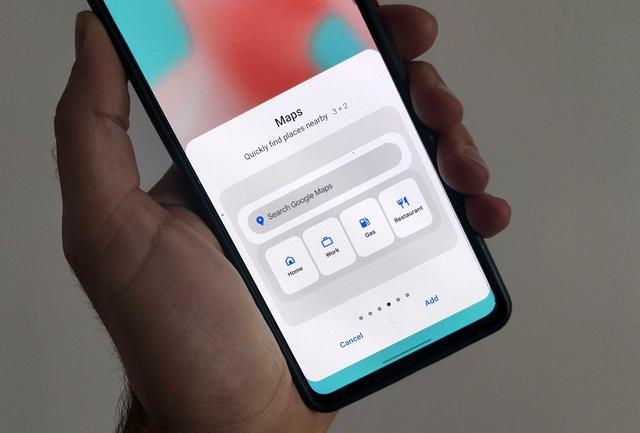

Adieu Touch Bar, je ne te regretter...
Caddy, l'unique serveur web à utili...
Burkina Faso / Gabon (TV / Streamin...
Ce que le futur du travail ne sera...